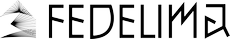PLAIDOYER POUR UNE MEILLEURE DÉCOUVERTE DES MUSIQUES DU MONDE FRANCOPHONE, DE LEURS CULTURES ET DE LEURS LANGUES DANS L’ENVIRONNEMENT NUMÉRIQUE
Rappel préliminaire
Il y a trois ans, Les Productions Nuits d’Afrique ont lancé le Laboratoire collectif La Percée, qui réunit artistes, professionnels de la culture et chercheurs pour analyser et mettre en lumière les défis de découvrabilité en ligne des Musiques du Monde.
En 2023, Zone Franche, le réseau des Musiques du Monde, est devenu partenaire et coréalisateur de La Percée pour son déploiement international, en mettant en œuvre la force et les synergies d’un réseau de professionnels présent sur plusieurs continents.
C’est ainsi que La Percée a pu aller à la rencontre des professionnels dans divers moments dont des salons internationaux en France (Babel Music XP, MaMA), en Afrique (MASA en Côte d’Ivoire, Visa For Music au Maroc), et lors d’un événement majeur : le Sommet de la Francophonie, à Paris, au mois d’octobre 2024.
Alors que la France Music Week a réuni ce mois de juin, à Paris, les géants de l’industrie musicale, dont ceux du numérique, nous publions ce plaidoyer fruit de ces années de concertation et de réflexion. Il interpelle l’ensemble des acteurs concernés pour préserver, promouvoir et faire rayonner, dans l’environnement numérique, la riche diversité des expressions musicales émanant des pays de l’espace francophone.
Nous appelons les professionnels de la musique de toute catégorie (salles et festivals, producteurs, salons, réseaux et fédérations, syndicats et collectifs, OGC, etc.) sensibles à ces enjeux à signer cet appel (lien ci-dessous) afin de poursuivre et élargir les échanges.
Le plaidoyer
Les services de diffusion de musique en continu (Spotify, Deezer, Apple Music, etc.) séduisent déjà plus d’un demi-milliard d’abonnés payants. Selon la Fédération internationale de l’industrie phonographique, 59 % du temps que nous consacrons chaque semaine à écouter de la musique est passé sur ces services. Si l’on peut se réjouir de l’accès qu’elles donnent à une pléthore de contenus, soyons aussi conscients que les plateformes nous enferment dans une bulle d’écoute d’œuvres musicales qui se ressemblent et qui ne correspondent pas toujours à nos préférences.
Des études conjointes menées par le laboratoire collectif La Percée, des Productions Nuits d’Afrique, et la Chaire UNESCO en communication et technologies pour le développement de l’Université de Québec à Montréal montrent que les systèmes de recommandations algorithmiques promeuvent surtout des courants musicaux dominants et internationaux déjà populaires, au détriment de productions nationales, régionales et locales moins connues, notamment dans l’espace francophone.
Pour l’heure, les plateformes de streaming ont tendance à ne pas valoriser ni véritablement favoriser la circulation et la découverte de la riche diversité du patrimoine musical francophone disponible en ligne, dont les œuvres et les créations musicales des artistes francophones d’Afrique, des Caraïbes, des Antilles et de l’Amérique latine.
Ce qui est préoccupant, c’est de constater par exemple que sur Spotify, on ne compte qu’un seul artiste francophone parmi les 20 artistes africains les plus écoutés, ce qui illustre la domination des productions anglophones et la difficulté pour les artistes francophones d’accéder à une audience mondiale. Par ailleurs, les récentes mesures et observations réalisées par le laboratoire La Percée, en étroite collaboration avec la firme Gradiant AI, permettent également de conclure qu’à niveau de popularité comparable (mesuré en nombre d’abonnés Spotify), les artistes de musiques du monde bénéficient en moyenne de 40 % moins d’exposition (et donc moins de découvrabilité) dans les playlists éditoriales de la plateforme que les autres artistes associés à d’autres catégories ou genres musicaux.
S’enfermer dans une bulle musicale restreinte
Puisque les deux tiers de toutes les écoutes sur Spotify se font à partir des listes de lecture, ce chiffre illustre une faible recommandation et mise en valeur de la grande richesse et de la diversité de la scène musicale francophone, par l’invisibilisation des artistes issus de l’immigration ou de la diversité et catégorisés dans des genres musicaux minoritaires. Cette sous-représentation devient particulièrement problématique lorsque l’on considère que les playlists représentent un gain considérable d’écoutes pour les artistes.
En effet, l’écart d’exposition de 40 % se traduit directement par un déficit de visibilité, de perspectives économiques et de reconnaissance pour les artistes concernés. L’absence relative des artistes de musiques du monde dans ces vitrines privilégiées limite considérablement leur capacité à atteindre de nouveaux publics, créant un cercle vicieux où le manque d’exposition initiale réduit les chances d’une découvrabilité et d’une popularité future.
De plus, les systèmes de recommandation des grandes plateformes privilégient les contenus déjà populaires ou issus de marchés dominants, ce qui renforce la marginalisation des musiques francophones de niche ou appartenant à des catégories et à des genres musicaux moins populaires. Les statistiques montrent notamment une faible proportion de streams et de titres pour ces répertoires dans les classements des morceaux les plus écoutés.
L’auditoire se retrouve donc enfermé dans une bulle musicale restreinte qui limite son exposition à la diversité dont se targuent pourtant les catalogues des services de streaming.
Ce phénomène de concentration des écoutes musicales en ligne creuse l’écart entre les succès largement promus et les artistes ou les titres moins connus, moins visibles et donc moins découvrables. Rappelons que, parmi les dizaines de millions de morceaux téléversés sur les plateformes en 2024, près de 80 % n’ont jamais été écoutés, selon Deezer. Ainsi, la diversité de l’offre disponible en ligne ne se traduit pas dans la consommation réelle de musique.
Passer de l’indignation à l’action
Cette tendance à la standardisation culturelle risque de s’accentuer à l’ère de l’IA générative, qui pourrait avoir des effets négatifs sur la diversité linguistique des contenus culturels auxquels nous sommes exposés. Avec la prolifération des contenus créatifs et culturels créés par l’IA, il devient aussi crucial de se préoccuper des risques de dévalorisation des œuvres humaines, d’une rémunération inéquitable des artistes, du non-respect des droits d’auteur et de l’intégration non autorisée de grandes quantités de musique pour l’entraînement de modèles de langage.
Selon la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs, d’ici 2028, près de 20 % des revenus des plateformes de diffusion en continu et 60 % de leurs musicothèques pourraient provenir de musique générée par l’IA, ce qui entraînerait une perte radicale de revenus, estimée à une dizaine de milliards de dollars, pour l’industrie musicale au cours des années à venir.
Sans politiques publiques, réglementation ni lois adaptées en matière de culture, de découvrabilité, de droits d’auteur et de régulation des plateformes de diffusion en ligne et des systèmes d’IA, les géants du Web continueront à hiérarchiser nos productions culturelles, décidant de ce qui « mérite » d’être vu, entendu et recommandé, selon des critères opaques et motivés par la seule rentabilité.
Pour que ces plateformes fassent partie de la solution, elles doivent revoir leurs modèles afin de promouvoir plus d’équité, de diversité et d’inclusion, dans l’intérêt de leurs publics diversifiés et aux goûts éclectiques. Voir sa culture, sa langue et son identité représentées en ligne, c’est exister. Il y va de notre humanité commune, qui doit continuer à s’enrichir des vertus du dialogue interculturel. Il importera aussi de sensibiliser et d’éduquer les jeunes francophones afin qu’ils adoptent des comportements culturels plus responsables en ligne et qu’ils développent une appétence et une curiosité pour l’exploration musicale des voix d’expression multiculturelle.
Parce que la diversité des contenus en ligne est cruciale pour notre souveraineté culturelle, nous devons passer de l’indignation à l’action. Il s’agit d’empêcher une déshumanisation de la découverte musicale et de garantir dans l’espace francophone et partout dans le monde un accès équitable à une plus vaste palette de contenus musicaux en français ainsi que dans les autres langues nationales et locales coexistant dans la francophonie, qui contribuent à l’enrichissement culturel de chacun.
Il est urgent de ne pas laisser nos musiques et cultures francophones entre les mains d’une économie de marché dominée par quelques entreprises transnationales qui imposent à notre attention ce qu’il faut écouter, à partir des formules magiques de leurs algorithmes.
Le droit de découvrir
Pour que la magie des algorithmes opère, les plateformes de diffusion doivent comprendre qu’il est possible de mettre en valeur et de promouvoir la diversité des expressions nationales et locales sans nuire à leurs intérêts, à ceux de l’industrie musicale ou du public.
Il importe également de coconstruire un vocabulaire commun, en produisant de nouvelles taxonomies inclusives et en améliorant les pratiques d’indexation plus fine des œuvres (tenant compte des spécificités linguistiques et culturelles), de sorte à ainsi refléter la pluralité des genres musicaux au lieu de les regrouper dans des catégories génériques.
Nous, regroupements professionnels d’artistes et de créateurs, acteurs de l’industrie musicale, chercheurs et experts en découvrabilité et politiques culturelles, demandons qu’on reconnaisse le droit de chacun à découvrir, consommer et partager des contenus reflétant sa culture et sa langue et à y accéder, sur n’importe quelle plateforme.
Nous en appelons aux États, gouvernements et organisations internationales : adoptez et appliquez des normes, des principes, des directives, des traités, des protocoles, des politiques publiques, des lois, des règlements et toute mesure proactive en matière de découvrabilité culturelle, de soutien à la transformation numérique des secteurs culturels, de régulation des plateformes et d’encadrement de l’IA pour protéger et promouvoir en ligne la diversité des expressions musicales des pays francophones. C’est aussi à nos décideurs publics de prendre des mesures pour soutenir le renforcement des compétences numériques, la formation et l’accompagnement des artistes, des créateurs et des professionnels francophones afin qu’ils puissent mieux référencer leurs œuvres (mots-clés, métadonnées, stratégies de promotion) et ainsi améliorer leur découvrabilité.
Soucieux de l’intérêt public et des choix déterminants pour l’avenir de nos sociétés, dans un contexte où le rapport de force favorise les géants du Web guidés par leurs seuls intérêts économiques, nous devons rester mobilisés, chacun dans l’exercice de ses responsabilités, pour mener ce combat nécessaire. Abdiquer reviendrait à laisser ces multinationales écraser la souveraineté culturelle à laquelle aspirent les peuples et les nations francophones. Nos acquis en matière de protection et de promotion de la diversité des expressions culturelles sont aujourd’hui gravement fragilisés et remis en cause.
Cet engagement est essentiel pour assurer la pérennité du pluralisme musical et préserver notre capacité à faire découvrir une culture francophone vibrante, que créateurs et publics de tous horizons pourront s’approprier à leur tour.
Destiny Tchéhouali, Professeur en communication internationale à l’UQAM, Titulaire de la Chaire Unesco en communication et technologies pour le développement et Directeur scientifique du Laboratoire La Percée
Johan Lauret, Directeur de projet du Laboratoire La Percée
Suzanne Rousseau, Directrice générale et co-fondatrice des Productions Nuits d’Afrique
Sébastien Laussel, Directeur de Zone Franche, le Réseau des Musiques du monde
Lire le plaidoyer
Signer le plaidoyer